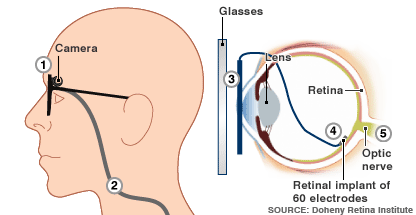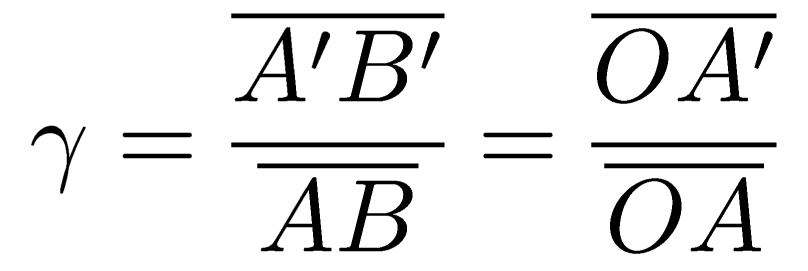Prothèses
La Prothèse oculaire
a.définiton et fonctionnement des prothèses oculaires
La rétine de l’oeil est constituée entre autres de 2 types de cellules sensibles a la lumière: les cellules photorécéptices et un réseau de neurones. Les premières transforment les signaux lumineux en signaux électriques et stimulent des neurones, qui acheminent les messages jusqu’au cerveau via le nerf optique. La défaillance des photorécepteurs altère la vue et peut conduire à la cécité.
La rétine artificielle remplace ces cellules afin de stimuler les neurones résiduels de la rétine et rendre en partie la vue à ces personnes. Il s’agit notamment d’un implant de 3 mm fixé sous la rétine et composé d’électrodes qui stimulent les neurones rétiniens.
Notre premiere expérience consiste en imiter le rôle des cellules photoreceptrices, c’est à dire de transformer les signaux lumineux en signaux electriques. Afin de montrer que l’énergie éléctrique est convertie en energie lumineuse, nous avons utilisé une photopile.
Nous avons branché la photopile a une DEL et a un multimètre, puis nous avons allumé la lampe, et le multimètre a mesuré 1,7 miliampères. Cette énergie a allumé la DEL. Nous avons donc montré que la photopile, qui imite le role de la rétine, transformait l’énergie lumineuse en énergie éléctrique.
Montage avec Photopile:
non eclairée : LED eteinte Puis photopile eclairée: LED allumée
Toutefois, avant d’arriver à la rétine, la lumière traverse le cristallin, la lentille convergente de l’oeil. Cette lentille permet la formation des images inversées sur la rétine, et nous avons démontré ceci en modélisant un oeil. Nous avons utilisé une source lumineuse devant laquelle etait placée un objet lumineux. La lumière issue de cet objet, apres avoir traversé le cristallin, forme une image a l’envers sur l’écran qui represente la rétine.
Montage de modélisation de l’oeil
Schema de l’image inversée:
source:http://www.mescours.info/Image/physique_spe/demo.gif
Pour construire l’image A’B’ d’un objet plan AB, orthogonal à l’axe optique avec A appartenant a cet axe, on construit l’image B’ du point objet B: B’ est situé a l’intersection de tous les rayons issus de B. Il faut pour cela choisir deux rayons; l’un passant par le centre optique (O), et l’autre passant par l’un des foyers (F). Il faut ensuite construire le point A’, tel que A’B’ soit orthogonal a l’axe optique.
Voici la formule du grandissement :
b.amélioration du quotidien
Avec les dispositifs actuels d’implants, la vision que recouvre les patients est forcément partielle et grossière. Ils ne voient qu'en noir et blanc, et distinguent surtout des formes et des couleurs très contrastées. Comme le capteur ne recouvre pas toute la surface de la rétine, mais seulement une zone de 3 mm de côté, leur champ de vision ( portion de l'espace vue par un œil regardant droit devant lui et immobile. Lorsque l’œil fixe un point, il est capable de détecter dans une zone d'espace limitée, des lumières, des couleurs et des formes.) est réduit à l'équivalent d'une pochette de CD tenue à bout de bras.
(source:http://www.centre-ophtalmologique.com/uploads/page-centre-haut-paves/image-champs-vision.png)
Malgré ces limitations, ces premiers succès sont très encourageants pour ceux qui ont perdu la vue à la suite d'une rétinopathie pigmentaire, une maladie dégénérative qui détruit les cellules de la rétine.
Ainsi, deux patients anglais par exemple, aveugles depuis plusieurs années, ont retrouvé une perception partielle de la vue grâce à l’implantation de rétines artificielles. Ces mêmes implants devraient aussi être testés dans le futur sur des personnes souffrant de dégénérescence maculaire (détérioration de la macula, une petite zone de la rétine située au fond de l’oeil, près du nerf optique. Elle entraîne une perte progressive et parfois importante de la vision centrale, qui devient de plus en plus floue.)
L’observation d’une image complexe (paysage ou visage) permet de comprendre immédiatement le premier challenge des prothèses rétiniennes qui tient dans la nécessité d’augmenter le nombre de microélectrodes et donc leur densité.
Il faut compter 73 000 euros pour le modèle Argus II, deuxième génération du modèle Argus, créé en Californie en 2009. Pas à la portée de toutes les bourses donc. En Europe, une soixantaine de patients en ont pour l’heure bénéficié.
De plus, il faut préciser que la pose de ce type d’implant nécessite un geste de chirurgie hautement spécialisé. L’intervention dure plus de quatre heures et ne peut être réalisée que par des chirurgiens très expérimentés.
(source: http://www.sopeople.fr/wp-content/uploads/2013/02/42581541_bionic_eye2_416.gif)
Sources: sujet du bac de sciences 2012, L et ES